-
« Hélas, petits Moutons »
La pastorale n’est pas, chez Deshoulières, un simple genre parmi d’autres : elle constitue l’un des ossatures du recueil et un véritable laboratoire poétique et éthique. Elle innerve tout un pan de la production, depuis les premières idylles (« Les Moutons », 1677, p. 123 ; « Les Oiseaux », 1679, p. 187) jusqu’aux années 1680 avec « Le Ruisseau » (1685, p. 215) et « L’Hiver » (1688, p. 250), mais aussi quatre églogues et des idylles d’occasion au service du prince (« Pour la naissance du duc de Bourgogne », 1682, p. 116 ; « Sur le retour de la santé du Roi », 1686, p. 197). Les petites formes plus courtes (airs, chansons) qui prennent volontiers des allures d’interlude entre des poèmes plus ambitieux, s’inscrivent presque systémariquement dans un cadre pastoral.
Cette tonalité pastorale dominante participe pleinement de la stratégie de déflation des fausses valeurs et de promotion d’un art de vivre fondé sur le style moyen. La poétesse prend soin de dépassionner l’amour pétrarquiste et désublime l’éloge, mais elle peut s’abandonner librement à la pastorale qui correspond si bien à son éthique épicurienne de la modération et de la tempérance. La forme bucolique privilégie l’horizontalité tranquille, un otium au sein d’un locus amoenus fait de ruisseaux, de zéphyrs, de masques de bergers, loin de tous les excès de la passion, et de toutes les hyperboles de l’encomium. Ce cadre convient idéalement à la poétique mondaine, d’autant que le récit d’un roman comme L’Astrée s’interrompt souvent pour laisser les personnages chanter des airs et des chansons, ou graver des sonnets sur des arbres.
La pratique de la pastorale, dans les années 1680, ne saurait être considérée simplement comme la reprise paresseuse ou nostalgique d’une mode passéiste, dont les grandes heures dateraient de l’époque d’Honoré d’Urfé et de son Astrée (1608-1625). La mièvrerie apparente (pour ne pas dire kitsch) des petits moutons et des bergers en taffetas ne doit pas nous tromper : la pastorale était, dans la seconde partie du XVIIe siècle, un enjeu littéraire central, auquel René Rapin avait consacré une Dissertation dès 16591 . La pastorale devait ensuite devenir un des lieux d’affrontement majeurs lors de la Querelle des Anciens et des Modernes ; peu après la parution du recueil de Deshoulières, en 1688, Longepierre, partisan des Anciens, fait paraître une traduction de Théocrite2 , à laquelle Fontenelle réplique la même année par des Poésies pastorales, avec un discours sur la nature de l’églogue3. Pour en résumer très brièvement les enjeux, à la conception « ancienne » de l’églogue-peinture des amours et travaux des bergers, défendue par Rapin et Longepierre, répond la définition « moderne » de la pastorale selon Fontenelle, promoteur d’un genre affranchi du rusticum, apte à dire l’aspiration humaine au repos et au bonheur, en un mot moins rustre que peuvent parfois l’être les idylles grecques.
Si les pièces composées par Deshoulières, et réunies dans un volume dont l’achevé d’imprimer est daté de décembre 1687, sont légèrement antérieures au déclenchement de la polémique Longepierre-Fontenelle, dont les ramifications se poursuivront jusqu’au XVIIIe siècle, Deshoulières ne s’en situe pas moins au coeur d’un débat très vif. Elle représente à bien des égards dans cette querelle une troisième voie, soucieuse certes de renouveler la tradition antique, mais en respectant la lettre et l’esprit des églogues et des idylles de jadis. Si la poétesse débarrasse l’idylle d’une certaine grossièreté présente chez Théocrite, elle lui donne une dimension réflexive où, fidèle à la leçon des Anciens, la Nature occupe une place essentielle.
La pastorale mondaine ne se réduit pas chez elle à un décor champêtre aimable : elle propose, à l’usage des ruelles, un modèle normatif de sociabilité. Dans la France galante, l’idéal de société auquel aspirent les mondains tend à se fonder sur la réciprocité, le respect des désirs, l’agrément mutuel et une esthétique de la douceur. Ce cadre axiologique trouve dans la pastorale utopie opératoire : une Arcadie sobre, fait de plaisirs simples, de conversations, de poésie et de musique. L’idylle chez Deshoulières met en scène ces affects tempérés et ces joies modestes qui correspondent, non sans un certain paradoxe à nos yeux, à l’idéal de cette élite urbaine et parisienne. En réalité, l’ « otium » mondain, qui institue un temps et un espace de retrait dans la société même, est la transposition salonnière de la solitude pastorale, dont elle partage les valeurs. Le rêve pastoral convertit la ville en campagne symbolique pour dire une politique de l’agrément et offrir un imaginaire de pacification des hiérarchies par l’art de plaire.
Sur le plan poétique, la pastorale devient chez Deshoulières une scène d’énonciation privilégiée, sur les « bords de Lignon » (p. 167) ; son programme poétique conjugue poésie et retrait bucolique. La parution de plusieurs idylles dans Le Mercure galant, affichant l’inscription des pièces dans l’esthétique de l’agrément mondain, n’empêche pas toutefois la poétesse d’y rechercher une vraie densité méditative. Deshoulières parvient à joindre l’utile au doux : la « nature » pastorale est principe d’orientation de la vie bonne. Si l’on doit chercher un centre de gravité du recueil, il est là, sur le rivage de ces pièces pastorales qui organisent la diversité du livre, du “bord des ruisseaux” aux salles de l’Académie, de l’Arcadie rêvée aux deuils très réels.
Philosophiquement, la pastorale, en tant que poésie « naturaliste », porte aisément la veine épicurienne de l’autrice : la nature, correctement observée, permet de définir les critères du vrai bonheur, conçu comme absence de trouble, mesure des désirs, modération des plaisirs. Deshoulières ne propose pas de « suivre la nature » au sens où les stoïciens entendaient cette formule, c’est-à-dire comme une adhésion à l’ordre rationnel du monde. Vivre κατα φυσιν, pour les Epicuriens, c’est chercher dans la Nature le moyen d’accéder à l’aponie (absence de douleur physique) et à l’ataraxie (absence de trouble de l’âme) dans une autarcie (αυταρκεια), solitude qui n’exclut pas l’amitié. La Nature des idylles rend inversement sensibles les mirages que sont la gloire, la richesse, le raffinement et l’amour-propre, qui n’apportent pas la véritable voluptas identifiée au bonheur (« L’Ambition, l’Honneur, l’Intérêt, l’Imposture, / Qui font tant de maux parmi nous, / Ne se rencontrent point chez vous », c’est-à-dire chez les Moutons paissant dans la nature, p. 124). Les idylles de nature deviennent ainsi une critique douce mais ferme de l’anthropocentrisme classique : les moutons sont « plus sages que nous » (p. 124) avec leur seul instinct, tandis que la « fière raison » humaine est à la fois « impuissante » (« Contre les passions », elle « n’est pas un sûr remède », p. 124) et source de malheur (« déchirer un cœur » est « tout l’effet qu’elle produit »). « L’indolence » des bêtes est préférable à la « chimère » de la raison, mais aussi à toutes les « trésors » que nous mettons à si haut prix et qui ne sont que « vanité » : « des Richesses, de la Naissance, de l’Esprit et de la Beauté ».
Au-delà de la dette envers un modèle narratif qui modela profondément l’art de vivre des salons, le code pastoral épouse l’option naturaliste de Deshoulières : au lieu d’héroïser le manque comme le faisait le pétrarquisme, la scène bucolique naturalise le désir, l’accorde aux saisons, fait de la douceur une force sans emphase. L’Arcadie de Deshoulières, on le voit d’emblée, n’a rien de naïf. La pastorale sait la mort tapie dans l’ombre de ces paysages semés de tombeaux et de fleurs fragiles, de sorte que l’idylle oscille entre le refuge et la lucidité.
Il faut enfin rappeler l’usage stratégique de la pastorale « à grand public » : les pièces bucoliques encomiastiques inscrivent la voix pastorale dans la liturgie monarchique, élargissant la gamme d’une poètesse de salon vers le grand genre officiel. Mais même là, Deshoulières module ce registre en lui conservant son profil propre : entre « Dieu des Guerriers » et « Dieu des Amants » (p. 105), elle revendique une liberté de ton et de matière qui relie pastorale, politique et poétique personnelle.
Si, au fond, Deshoulières s’abandonne plus facilement à l’esthétique pastorale qu’aux codes désuets du pétrarquisme, c’est qu’elle ressent moins la nécessité d’en dégonfler les prétentions mystiques. Elle avait bien compris que L’Astrée n’était pas cette hymne au néoplatonisme que les critiques modernes ont parfois voulu lire : le roman d’Honoré d’Urfé est travaillé par des forces centrifuges qui entravent son élan vers l’idéal. Les bergers jouent à l’amour, portent des masques, les échangent parfois, et tous ne sont pas des modèles de fidélité. Dans la joyeuse inconstance d’Hylas, le berger volage, « patron des indiscrets » (p. 484), Deshoulières trouve déjà une figure pour penser son rêve de bonheur humble en harmonie avec les cycles de la nature.
Dans les prochains billets, nous envisagerons le rapport de Deshoulières à la pastorale en observant comment Deshoulières rejoue la lyrique amoureuse en s’adossant à L’Astrée, en se mesurant aux Anciens (Théocrite et Virgile en particulier) et en s’inscrivant, en Moderne, dans les pratiques du Mercure galant. À travers noms et rôles (Iris, Tircis), topographies (bords de Lignon, ruisseaux, tombeaux), formes brèves (idylles, églogues, airs, chansons) et pragmatique de la réplique, nous verrons comment la pastorale devient, chez elle, non pas un décor doucereux, mais une machine de réorientation du lyrisme.
- René Rapin, Dissertatio de carmine pastorali / Dissertation sur le poème pastoral, éd. Pascale Thouvenin, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque du XVIIe siècle », 2014. [↩]
- H. B. de Longepierre, Les Idylles de Théocrite, Paris, Aubouin, Emery, Clouzier, 1688. [↩]
- Bernard de Fontenelle, Poésies pastorales, avec un discours sur la nature de l’églogue, Lyon, Thomas Amaury, 1688. [↩]
-
Journée d’Agrégation à Lyon : 7 novembre
Vendredi 7 novembre 2025
Université Lumière Lyon 2
(Salle Bélénos 202 : entrée par le 5 rue Chevreul ou 4 rue de l’Université, 69007 Lyon)
Pour les étudiant·es extérieur·es au site Lyon – Saint-Étienne, merci de vous inscrire en écrivant à :
mathilde.bombart[at]univ-lyon2.fr et edwige.keller[at]univ-lyon2.fr
La journée ne donnera pas lieu à une retransmission à distance.
Présidence de séance : Edwige Keller-Rahbé
9h30 : Fanny Boutinet (Univ. Perpignan), « « Quel espoir vous séduit ? » Les adresses féminines dans les Poésies »
10h00 : Elise Legendre (Univ. Paris Sorbonne), « Ballades et rondeaux en »vieux langage » : l’archaïsme chez Deshoulières »
10h45 – Pause
Présidence de séance : Michèle Rosellini
11h15 : Guillaume Peureux (Univ. Nanterre), « Des vers « si suivis & si naturels qu’on sait ce qu’elle va dire, avant mesme qu’on l’ait lû. » Le travail de la négligence métrique chez Deshoulières »
11h30 : Léa Burgat-Charvillon (ENS Lyon), « Le plus petit des reptiles, le roi et la poétesse : présence de la maladie dans les Poésies de Deshoulières »
12h45 : Pause déjeuner
Présidence de séance : Isabelle Moreau
14h30 : Mathilde Bombart (Univ. Lyon2) et Maxine Dupont-Pieri (ENS Lyon), « Du Mercure au recueil : les politiques de l’œuvre de Deshoulières »
15h : Michèle Rosellini (ENS Lyon), « Deshoulières épicurienne ? »
15h30 : Eric Tourrette (Univ. Lyon3), « « De quel aveuglement sont frappés les humains ! »»
- Responsable :
Edwige Keller-Rahbé et Mathilde Bombart - Url de référence :
https://ihrim.ens-lyon.fr/manifestations/article/antoinette-deshoulieres-poesies - Adresse :
Université de Lyon 2 – voir sur une carte
Plus d’information: https://www.fabula.org/actualites/130415/journee-d-etudes-agregation-litterature-du-xviie-siecle-antoinette-deshoulieres-poesies.html
- Responsable :
-
Antoinette Deshoulières, Poésies
Paru le 16 octobre
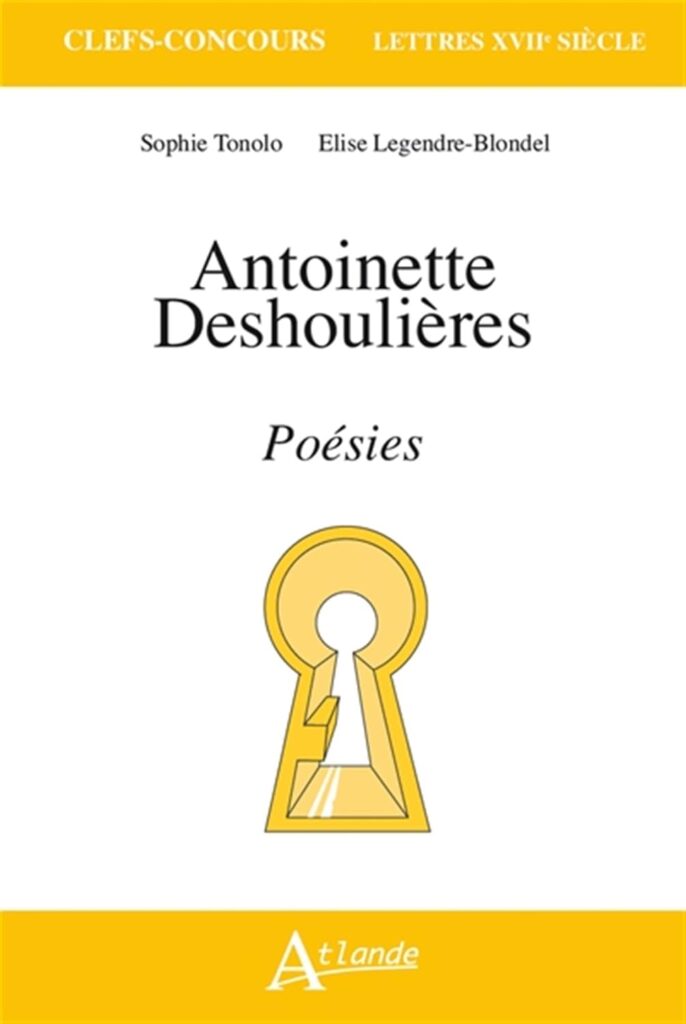

Le chant du bonheur.
Introduction à la poésie d’Antoinette Deshoulières
NAVIGATION

